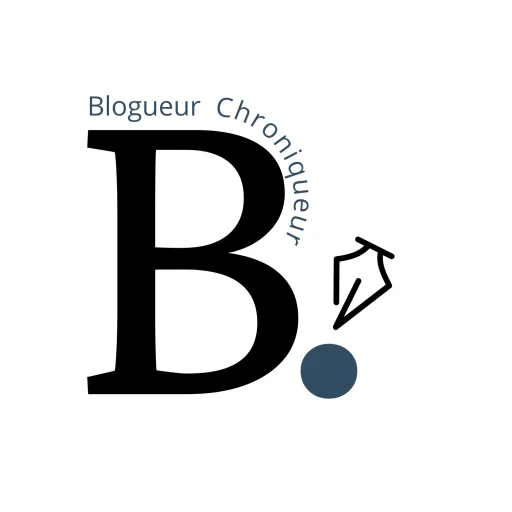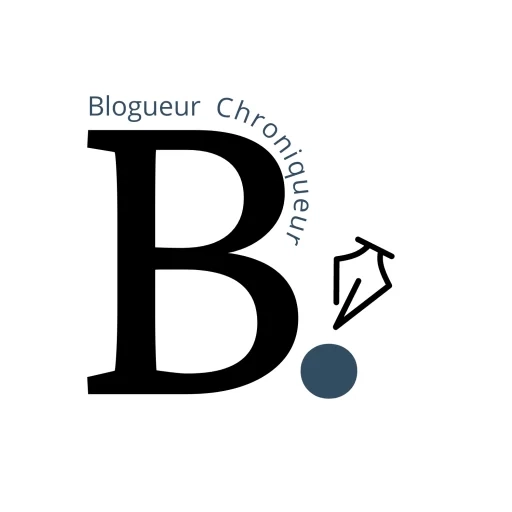Journal en temps de coronavirus: Patville Le Feuilleton, un feuilleton fiction, écrit par Yves Carchon, autour du coronavirus. Retrouvez l’intégralité du chapitre 12 « Le vent du malheur». A suivre tous les vendredis.

Patville, Journal en temps de coronavirus
Chapitre 12 : Le vent du malheur
Avec tout ça, en plus du pataquès Reno-Cooper qui avait libéré les langues, le vent s’y était mis. Un foutu vent, bousculant tout sur son passage. Peut-être qu’il voulait être de la partie, le vent, comme un prélude à ce qui allait suivre. Une sorte d’oiseau de malheur.
Un vent qui venait du désert, cinglant Patville à grands coups de boutoir comme s’il voulait lui mettre une torgnole, à not’ village. Chaque maison, chaque recoin avait reçu son lot de gifles et de rafales. Le sable avait fondu sur nous, couvrant les rues, stagnant sur les trottoirs, s’accumulant sur les pas-de-porte et recouvrant le pare-brise des voitures.
Des tourbillons qui se levaient et couraient par les champs, pareils à des tornades en boucle s’élançant vers le ciel, fantômes qui tournoyaient et se contorsionnaient avant de s’éloigner.
Du sable, on en avait partout. Il s’incrustait dans nos cheveux, nos poches et nos galoches. Et tout ce qu’on touchait était couvert d’un grain sableux. Emy, dans le bureau de Jeff, qui travaillait souvent fenêtre ouverte, avait dû la fermer.
Elle ne supportait pas le vent, et encore moins le sable. Mais comme elle avait chaud à l’intérieur, elle s’était dégoté un vieux ventilateur qui avait décoiffé sa frange sur le front, quand elle l’avait branché.
« Je déteste tout ce sable et voudrais bien savoir quand va tomber ce maudit vent ! » avait-elle rouspété en voyant Jim entrer dans le bureau. Jim, venu là dans l’espoir de glaner des nouvelles toutes fraîches, s’était comme ravisé.
Il était à deux doigts de tourner les talons. Mais un détail l’avait décidé à rester : elle était seule, pas de Collins pour la faire taire. Sa langue s’en trouverait donc plus déliée et qui sait débridée. Il l’avait donc aidé à mettre en route l’antique ventilateur.
« Heureusement que tu es là ! », avait-elle dit à Jim, en caressant sa joue.
Mais comme elle se penchait vers lui, Jim avait eu direct une vue plongeante sur son putain de décolleté. C’est ce qu’il m’avait raconté plus tard, l’œil à moitié luisant. Il avait même surpris, à la naissance de ses seins, un grain de sable qui brillait. « Tu te rends compte ! Il a une sacrée chance, le sable ! » qu’il avait ri en me donnant une bourrade.
Ayant tenté d’en savoir plus sur la suite, j’avais eu droit à des broutilles. Jim était resté évasif, comme si une chose l’embarrassait. « Ne me dis pas… » que j’avais dit, en lui lançant l’œillade du siècle. — Quoi ? — Eh bien… toi… et Emy… « Eh, tu déconnes, Lenny, qu’il m’avait rabroué, piquant un phare. Emy est une amie ! »
Peut-être qu’elle était son amie, mais Jim, depuis des jours, se comportait bizarrement, ça, je l’avais noté. Je m’étais dit que ce putain de vent nous rendait tous dingues, moi le premier. Aucun de nous n’était d’ailleurs réellement à l’abri. C’était sans doute la faute du vent si Jim était bizarre.
A la maison, Pa s’énervait très vite, nous avoinant à sa façon, pour un oui ou un non. Même Ma y avait droit, à ses raclées. A cause du vent, de ce vent chaud qui soufflait du désert et apportait dans les replis de ses bourrasques sécheresse, désolation, malheur, — chacun était à cran ou ensuqué. C’était pareil pour les bêtes.
Elles n’aimaient pas ce vent de merde. Elles le disaient à leur manière, en frappant du sabot ou en couinant, comme les gorets dans leur enclos. Même les vautours planaient curieusement. C’est Jim qui m’en avait parlé, et c’était vrai qu’ils semblaient saouls au ciel et qu’ils piquaient en vrille comme s’ils cuvaient une muflée. Les chevaux étaient plus nerveux, les chiens filaient le long des rues, la queue entre les pattes.
Le vent avait soufflé, sifflé, arasé tout sur sa lancée. La nuit, le jour, pendant une bonne semaine, sans s’arrêter jamais. A Patville, tout s’était déréglé. Les lignes de téléphone coupées ; plus d’électricité dans les foyers.
Et dans les airs s’étaient envolés pêle-mêle : le chapeau de Mme Holy, le parasol de Mme Samuel, le calicot publicitaire ceignant le kiosque à glaces ; des chaises en plastique léger ; l’enseigne du Cactus’ bar qu’on avait retrouvée à l’entrée du village, au bord de la rivière, devant la tannerie. La tannerie où travaillaient les ouvriers indiens que Jim connaissait bien, pour l’avoir visitée une fois en compagnie de Mr O’Hara.
Depuis ce jour, Jim avait ses entrées, ayant sympathisé avec un vieil Indien répondant au nom de Paco. Ça tombait bien qu’il connût ce Paco : avec pareil vent, pas question de traîner dans les rues. On avait donc trouvé refuge à la tannerie, certains d’apprendre une multitude de choses de la bouche de Paco.
C’est là qu’il s’était présenté à nous comme étant Sioux, venu du Dakota du Sud. On l’avait écouté en se bouchant un peu le nez, il faut le dire. L’odeur montant des peaux tannées étant vraiment prégnante, pour ne pas dire pestilentielle.
Une puanteur, ces peaux ! Je crois d’ailleurs qu’en arrivant Jim avait dû éternuer au moins trois fois. Paco avait bien ri. On n’était pas habitués, c’est tout. Faut dire que, lui, Paco était dans la tannerie depuis des lustres.
Son visage était tout ridé et ses mains tachetées. Un nez en bec d’aigle, des cheveux blancs et raides comme des crins, des yeux perçants qui vous scrutaient jusqu’au fond de votre âme. C’est lui qui nous avait appris que justement son nom Paco voulait dire en indien : aigle à la tête blanche. Ça lui ressemblait bien, c’est sûr.
Quand Jim avait voulu savoir si c’était vrai que les Indiens portaient des noms de bêtes sauvages, Paco avait ri à nouveau. Mais mieux valait encore ne pas le voir trop rire : sa bouche, aux dents noircies, était à elle seule un véritable cimetière à chicots !
Au moment de la pause déjeuner, alors qu’il mâchouillait une sorte de purée d’ignames et de haricots rouges, il nous avait parlé de la réserve indienne qui était née après la grande bataille de Little Big Horn, où avait combattu son illustre grand-père, feu Waneta Wapi.
Un terrible carnage, auquel très peu de Blancs avaient pu réchapper et où Custer avait trouvé la mort. Chez les Cheyennes, alliés aux Sioux pour la bataille, Custer était encore considéré comme un puissant guerrier. « Plus vif que l’éclair et plus rapide qu’une couleuvre, » qu’il avait résumé, Paco, en parlant de Custer.
Et l’on citait encore son nom dans le clan sioux, longtemps après sa mort. Little Big Horn avait ressemblé, paraît-il, à ces homériques batailles racontées dans l’Iliade, un bouquin que Mr O’Hara avait donné à lire à Jim, qu’il avait lu en diagonale mais qui l’avait marqué. « Tu le veux ce bouquin ?» m’avait demandé Jim. — Oh, moi, je lis comme ci comme ça… Tu sais que Pa déteste les bouquins ! » Jim avait bien compris. Il m’avait dit : « Pas grave, je te raconterai ! ».
Paco, comme moi, ne lisait pas non plus. Ce qu’il savait, c’était grâce à son père qu’il le savait, un père qui lui avait transmis avec des mots parlés ce que lui-même avait appris de ses père et grand-père. Et tous avaient reçu un même savoir, celui de leurs aïeux.
Les livres, c’était bon pour les Blancs. Les Sioux, eux, lisaient dans le ciel ou sur la piste, dans le sable du désert, sachant y déceler empreintes de bêtes et pas d’humains. Paco avait ainsi dévidé sa mémoire, voyant que Jim et moi étions captifs de ses mots.
Ce que j’avais aimé, c’était le déroulé des faits et gestes qu’il racontait, l’histoire de ses ancêtres narrée avec des mots à lui, dans un parler yankee, truffé de mots indiens, qui colorait l’incroyable odyssée de son peuple. Jim et moi en avions oublié l’infecte odeur qui émanait des cuves et où trempaient les peaux aux cent remugles.
Même le visage de Paco, avec son nez en bec de rapace et sa bouche édentée, avait fini par nous devenir proches et familiers, comme si, en nous parlant, il nous faisait entrer chez lui, sous son tipi, et qu’on était ses hôtes.
La fois où Jim avait visité la tannerie, accompagné de Mr O’Hara, celui-ci avait échangé avec Paco quelques mots en lakota, la langue sioux des plaines. Pour autant, il ne tenait pas longtemps une conversation en lakota, le père adoptif de Jim. Seulement un mot ou deux, égrenés ici ou là, appris où, comment : ça, on ne l’a jamais su.
En rentrant, Mr O’Hara avait expliqué à Jim que les mots en lakota s’inversaient dans une phrase et qu’un Sioux pour s’exprimer employait souvent des métaphores, quelque chose comme des images pour illustrer le sens d’un mot.
— Comment ça, avait demandé Jim.
— Eh bien, avait dit Mr O’Hara, une horloge par exemple se dit en lakota : le fer qui bouge, c’est-à-dire l’aiguille qui marque les heures et tourne sur son axe.
La tête de Jim ! Ça lui en avait bouché un coin, ça oui ! Et à moi donc ! Pas sûr que nous serions capables un jour de parler une telle langue ! Le lakota, ça n’était pas de tout repos apparemment.
Mais Paco s’était tu, intrigué par les sautes de vent plus violentes. Levant la main pour faire silence, il avait regardé vers les fosses où les autres étaient à leurs postes. Eux ne l’entendaient pas, le vent, car ils étaient déjà penchés sur leur labeur. Paco, si. Même qu’il s’en souciait et avait fermé les yeux pour se concentrer. Jim et moi étions restés suspendus à ses lèvres.
Des lèvres qui bougeaient muettement comme s’il se parlait à lui-même. En fait, il se mettait en lien direct avec le vent, mais ça, on l’avait appris bien après, quand Jim avait déniché un bouquin sur les Sioux dans le bureau de Mr O’Hara.
Ce qu’on voyait, c’est qu’il se recueillait, Paco, un peu comme Mme Holy au temple. Mais lui, il n’avait pas de temple, que le ciel au-dessus de sa tête et tous les éléments qu’il paraissait capter avec son corps.
Le vent avait fini par s’engouffrer dans le droit fil de la rivière pour aller se cogner aux murs de la tannerie, irisant l’eau des cuves, où macéraient les peaux. Ses rafales brutales avaient relancé les foulons sur leur axe, tonneaux énormes tout gorgés d’eau et de tanin.
Paco avait fait la grimace, comme quand il lui restait une bribe de tabac sur le bout de la langue. Ça ne lui plaisait pas, un pareil vent. Un vent qu’il connaissait, pour sûr, qui remontait à son enfance et qui s’était levé l’année où le village avait été victime de la funeste épidémie de choléra.
Beaucoup de morts et de malheurs restés ancrés dans les mémoires. « Le même vent, nous avait dit Paco, sauvage comme un mustang et plus fou qu’un dingo ». Le vent que le désert crachait comme un mauvais Esprit annonçant le malheur.
En l’écoutant nous raconter tout ça, Jim et moi n’en menions pas très large. Le vent, pour lui, était un peu comme une personne, enfin quelqu’un ayant une âme, comme aurait dit le Révérend. Il lui parlait au vent, Paco, et ils se comprenaient, lui et le vent. Voilà pourquoi il pouvait décréter, sans peur de se tromper, que ce vent-là était mauvais. Tout ça ne pouvait pas nous rassurer non plus. Il avait l’air d’en connaître un rayon sur le vent. Il ne nous restait plus qu’à boire ses paroles.
« Ce vent est le vent du malheur », qu’il avait répété, Paco. Et il avait levé les yeux au ciel, parlant du Grand Esprit qui condamnait les Blancs et leurs trafics, et tous les crimes qu’ils avaient perpétrés sur les tribus indiennes, et sur le sol et la prairie qu’ils avaient lézardés avec le soc de leurs charrues, et sur les eaux des fleuves et des rivières qu’ils avaient détournés, sur le carnage des bisons et sur le vol de leurs terres — pour tous ces meurtres-là, et pour bien d’autres, les Blancs devaient payer.
C’est ce qu’il lui disait, le vent, annonçant à l’avance un tragique châtiment.
« Après ce vent, viendra la pluie. Un déluge de pluie qui emportera tout », avait lancé Paco.
Selon lui, — il était encore jeune, l’année où s’était abattu le choléra sur le village, un même vent avait soufflé durant des jours, avec la rage d’une mère puma à qui l’on vole ses petits. On avait bien pensé qu’il tomberait comme il était venu. Mais la pluie était arrivée, et son troupeau de trombes avait inondé en une nuit une partie du village.
Et la rivière avait grossi et débordé, et détruit des maisons. Beaucoup de bêtes s’étaient noyées et leurs carcasses avaient été portées par le courant, bien plus loin en aval. La plupart des familles, cernées par la montée des eaux, s’étaient retrouvées isolées. On avait dû aller les secourir. Paco avait aidé son père à mettre à l’eau son canoë.
En chemin, comme il pagayait, avait raconté le père de Paco, on ne comptait plus les cadavres qui flottaient dans les rues. On en avait pas mal repêché, gonflés comme des outres. Beaucoup de villageois blessés avaient été guidés vers un hôpital de fortune, le dispensaire des Terres Hautes refusant d’accueillir les déshérités de Patville.
Certains avaient voulu forcer le doc des Terres Hautes à accepter les gens souffrants. Mais à l’époque, les Blancs se tiraient dans les pattes, chacun voulant rester chez soi. Le doc avait dû renoncer à leur ouvrir les portes du dispensaire.
D’un geste, Paco avait chassé ce piètre souvenir et il avait une fois de plus tordu la bouche, comme s’il s’apprêtait à tirer sur sa pipe. En fait, une telle grimace préfigurait bien des ennuis, et peut-être plus encore, à voir ses rides se ramifier sur ses deux joues et son nez se froisser.
C’est juste après l’inondation que le choléra était apparu, montrant son groin hideux. Il s’était vite répandu, fauchant les plus fragiles et les enfants, puis les femmes et les hommes. Chaque foyer avait été touché ; les Blancs d’abord, l’eau de leurs puits ayant été souillée, alors que les Indiens puisaient leur eau à la rivière.
Le doc, descendu des Terres Hautes, avait interdit l’accès à ces puits. Beaucoup trop de gens se tordaient et se vidaient, mourant déshydratés et le visage tout bleu. Nous avions eu plus tard l’explication auprès du doc de Patville, au sujet des visages tuméfiés, « des visages cyanosés, qu’il avait dit le doc, suite aux vaisseaux sanguins qui avaient éclaté ».
Jim m’avait dit s’être endormi avec l’image d’une tête livide, posée à son côté sur l’oreiller. Vrai, c’était stupéfiant cet épisode épidémique raconté par Paco ! Tout ça, entrecoupé de mots indiens qu’on ne comprenait pas, mais qui avait rendu sa narration plus saisissante encore.
Le jour après notre rencontre avec Paco, le vent était presque tombé. De gros nuages gonflaient au ciel, prêts à crever. Ils dérivaient moins vite, stagnant sur le désert comme de grosses poches tout prêtes à se vider.
De rondes mamelles, gorgées de pluie, qui n’attendait qu’un signe pour se percer. Ce qui rendait les choses plus étranges, c’est qu’un rayon filtrait de la sombre nuée, éclairant tout Patville d’une pâle clarté, pareil à ces images pieuses que Jim m’avait montrées, où l’on voyait descendre d’un ciel obscur un rayon de lumière sur le front de l’enfant Jésus. C’était peut-être un signe, s’était-on dit, prophétisant que le village ne serait pas touché et que la pluie passerait son chemin.
Mais non ! Les premières gouttes étaient venues frapper la couche de sable agglomérée devant le bureau de Collins, au moment même où nous nous apprêtions à retourner chez nous. Jim m’avait dit avoir promis à Mme O’Hara de l’aider pour son cake au sirop de cactus.
Moi, je devais rejoindre Pa pour récurer l’auge à cochons et ramasser une bonne rangée de pommes de terre. « Avant la pluie ! » qu’il avait dit. Seulement voilà, elle était là, la pluie ! Je présumais qu’une fois la pluie finie, je devrais y aller et que là-bas, j’aurais une fois de plus affaire au ceinturon de Pa. Ça, je le voyais gros comme une maison ! Mais bon, rien ne me priverait jamais de mon amitié avec Jim.
A l’abri sous l’auvent du bureau de Collins, nous avions entendu la pluie jouer de sa scansion sur les toits de Patville et clapoter contre les vitres des maisons. Les poches au ciel avaient dû s’éventrer d’un coup, car elle tombait serrée et dru, la pluie. Puis le pick-up de Jeff s’était garé et Jeff en était descendu, courant entre les gouttes en bloquant son stetson sur la tête.
« — Hey, les gosses ! Vous voulez vous tremper ? Entrez donc à l’abri ! » qu’il nous avait lancé en nous ouvrant la porte du bureau.
Nous l’avions donc suivi, alors qu’un écran blanc de pluie s’abattait derrière nous.
Emy, assise derrière sa table de dactylo, lisait une sorte de roman-photo quand on était entré. « Une littérature à la con, bulles et dialogues à faire pleurer Margot, m’avait expliqué Jim. Que des histoires sentimentales ! Enfin, tu vois ! ».
Moi, ce que je voyais, c’étaient ses jambes fuselées qu’elle avait croisées sous la table et sa robe décolletée découvrant le sillon de ses seins. Levant la tête, elle avait gratifié chacun d’un beau sourire carmin, s’ouvrant sur des dents blanches qui valaient bien celles d’une speakerine.
Elle avait lâché sa revue et s’était proposé de nous faire du café. Jeff n’avait pas dit non, ayant d’abord tombé sa veste, puis enlevé sa lourde ceinture qui avait rejoint la patère, fixée derrière la porte d’entrée.
Ainsi, nous avions vu la crosse de son colt dépasser du holster. C’était, je crois, la première fois qu’on voyait tout son attirail. Il ne manquait que son étoile qu’il ne portait jamais. Ça nous avait fait drôle de reluquer son colt. On aurait bien aimé le prendre en mains, rien que pour voir.
Dehors, le tempo de la pluie martelait les toitures de Patville. Nous l’entendions déverser son trop-plein en une incessante et bruyante cataracte, noyant déjà la grande rue. Jeff, derrière les carreaux, avait hoché la tête.
— Ça n’augure rien de bon, avait-il dit. Si ça tombe toute la nuit, m’est avis que les routes seront demain impraticables. Et le village sera touché, avec des maisons inondées !
Emy l’avait rejoint, avec une tasse fumante en mains.
— Tu crois que l’eau peut monter jusqu’ici ?
— Ça se pourrait, avait dit Jeff.
A cet instant, nous étions loin d’imaginer que cette pluie-là aurait tout lieu d’être le début d’un terrible cataclysme. Mais pas celui qui aurait pu se concevoir, d’origine proprement naturelle. Un autre, beaucoup plus dangereux.
Celui qui devait provoquer une incroyable mutinerie au bagne d’Oraculo.
Tout ça parce que les routes étant coupées, Reno n’avait pas pu livrer en temps et heure Le Rat et ses sinistres sbires.
Patville, un feuilleton signé Yves Carchon, écrivain, auteur de « Riquet m’a tuer« , de « Vieux démons« , de « Le Dali noir », et de son nouveau polar « Le sanctuaire des destins oubliés »

Retrouvez
Covid-19 : Patville Le Feuilleton | Chapitre 11 | Nos morts
Covid-19 : Patville Le Feuilleton | Chapitre 10 | Un petit gars du Sud
Covid-19 : Patville Le Feuilleton | Chapitre 9 | Chagrin d’amour
Covid-19 : Patville Le Feuilleton | Chapitre 8 | Fils à papa
Covid-19 : Le Feuilleton | Chapitre 7 | Les Terres Hautes
Covid-19 : Le Feuilleton | Chapitre 6 | Collins contre tous
Covid-19 : Le Feuilleton | Chapitre 5 | Le bagne d’Oraculo
Covid-19 : Le Feuilleton | Chapitre 4 | Le village de nous autres
Covid-19 : Le Feuilleton | Chapitre 3 | Les culs terreux