Journal en temps de coronavirus: Le Feuilleton, un feuilleton fiction, écrit par Yves Carchon, autour du coronavirus. Retrouvez l’intégralité du chapitre 7 « Les Terres Hautes». A suivre tous les vendredis.

Journal en temps de coronavirus
Chapitre 7 : Les Terres Hautes
Ni Jim, ni même Don O’Hara n’auraient pu raconter mieux que le Doc comment était né le village de Patville. Au début, bien avant que n’arrivent les Blancs, les Indiens y avaient longuement vécu, période à plusieurs siècles.
Quand leurs descendants en parlaient, — des gars comme le Doc qui en connaissaient long sur la question, ils évoquaient les ancêtres-d’ancêtres-d’ancêtres. C’est dire !
Ça remontait probablement à la plus reculée nuit des Temps. Et le lieu même où ils avaient posé le camp était longtemps resté dans les mémoires sous le vocable village indien. Même encore aujourd’hui, certaines familles des Terres Hautes parlaient de Patville comme du village indien.
Village qui n’avait pas été construit en dur, pas même en bois, encore moins en pierre et pisé, ça non. Plutôt, comme qui dirait, un regroupement de tipis au bord de la rivière. Rivière qui, à l’époque, était plus haute, les propriétaires des Terres Hautes l’ayant plus tard captée et détournée pour leur seul profit.
Quand les Indiens avaient été chassés, les journaliers et autres esclaves marnant à la solde des colons s’y étaient installés, logeant dans des cabanes faites en rondins où le plupart du temps ils s’écroulaient, la nuit venue, harassés de fatigue, pour s’endormir comme des souches.
Certains ne dormaient pas, brisés par les brimades, le dos tout lacéré par les lanières des fouets ou les côtes tuméfiées par les crosses de fusils. Le reste de la journée ne leur appartenaient pas. Chaque jour de la semaine, dès le lever du jour, ils se levaient et roulaient leur rocher, interminablement.
Plus tard, Patville avait pris lentement l’aspect d’un campement où hommes et femmes, payés trois francs six sous pour s’épuiser aux champs, avaient fait souche. Le Doc parlait de ces Indiens revenus travailler sous les ordres des Blancs et qui s’étaient mêlés à eux.
Des Cherokees, pour la plupart, disséminés après les guerres indiennes, et qui s’étaient trouvés comme acculés aux portes du désert. Eux aussi avaient pris racine et partagé le pain avec des Blanches. Le Doc se souvenait de femmes noires, qui, ayant fui les comtés limitrophes où régnait l’esclavage, étaient venus grossir leur rangs.
Sur l’esclavage, le Doc était intarissable avec plein d’anecdotes dans sa musette de conteur, mais il s’était montré formel sur ce point : il existait partout en fait, l’esclavage. Noirs, Blancs, Indiens le subissaient également. Les pauvres, au fond, c’étaient eux les esclaves, ceux qui n’avaient ni toit, ni rien. Tous ceux qui cultivaient la terre des autres, pour sûr.
Le Doc avait parlé très longuement de son grand-père, quand quatre-vingt-dix ans plus tôt il avait échoué à Patville. Et comment il avait rencontré une Blanche, et comment, vrai, ils avaient copulé tous les deux avant que lui n’arrive au monde.
Tout ça, le Doc, il l’avait raconté, dans le menu détail, en parfait médecin. En l’écoutant, Jim et moi en étions restés sidérés. On savait bien pour les cochons et les chevaux, leur naissance et tout ça, mais les humains, ça non ! Il nous l’avait coupé, la chique, le Doc, en formulant précisément à quoi diable ressemblait une naissance humaine. Un vrai carnage, j’avais pensé. Jim s’était bien juré de ne jamais faire souche : « Oh, Dieu du Ciel, ça non ! Jamais, au grand jamais ! ».
Tout ça pour dire qu’autant le Doc était inépuisable sur l’histoire de Patville, autant sur celle des Terres Hautes il était moins bavard. Précautionneux, je dirais même. Par chance Mr O’Hara, lui, en connaissait un authentique rayon sur l’implantation des familles des Terres Hautes, devenues importantes quand on les évoquait, puisqu’on parlait alors de grandes familles. Cette expression, les grandes familles, faisait se bidonner mon copain Jim qui m’avait dit, hilare : « C’est vrai que nous, elles sont pas grandes, nos familles ! Elles sont même nombreuses ! »
Mais Mr O’Hara n’y trouvait pas matière à rire. Il faisait remonter l’arrivée des Anglais dans les années 1730. A l’époque, la variole avait décimé les Indiens, — de lourdes pertes humaines du côté Cherokee. Durant une courte période, les Indiens avaient acheté des armes aux Anglais pour combattre les Creeks. Alors qu’il racontait tout ça, Jim et moi on ouvrait de grands yeux. Et aussi nos oreilles. Même les Indiens entre eux ne semblaient pas en reste, se donnant de sérieuses peignées.
Mais le début de tout, c’est quand les tout premiers colons s’étaient mis à convoiter sérieux les terres indiennes. Et ces terres-là n’étaient pas de la friche, loin de là. « Les Cherokees n’étaient pas en peine ! Ils cultivaient déjà des haricots, des courges et des citrouilles, avait égrené Mr O’Hara, comme s’il avait vécu à cette époque.
Sans parler du tabac, du maïs qui n’avaient plus aucun secret pour eux ! Pour ça, c’étaient pas des manchots !». Il avait une tache rouge aux joues quand il nous racontait tout ça, Mr O’Hara, comme s’il s’échauffait. Bref, excitée par la poussée avide des colons cherchant de nouvelles terres, l’armée anglaise avait ravagé le pays cherokee.
La paix signée, les Indiens, après avoir cédé beaucoup de territoire aux Blancs, avaient dû se débrouiller comme ils pouvaient avec le peu d’arpents qui leur restaient. « Ah, oui ! Mais c’était sans compter avec leur grand courage, » avait poursuivi Mr O’Hara. Ils étaient devenus fermiers, en l’espace de vingt ans, ayant développé de belles plantations prospères. Ça n’avait pas duré : les colons les avaient chassés et avaient fait main basse sur leurs propriétés et leur bétail.
« C’est à ce moment-là, — donc juste après qu’on eut chassé les Cherokees, que se sont installé les pères des pères des grandes familles propriétaires des Terres Hautes qu’on connaît aujourd’hui. Les Cooper, arrivés les premiers, les Sanders. Enfin les Peterson, installés les derniers, après la Guerre de Sécession. » Là, Mr O’Hara avait soufflé, ayant brassé des décennies d’Histoire. Sûr qu’il devait avoir grand soif. Et là, comme par miracle, sa femme s’était pointée avec trois verres de jus de pomme, tombant décidément au bon moment. C’est vrai que Jim et moi, on avait soif aussi.
James Archibald Cooper était l’un des premiers à avoir mis la main sur le plus important cheptel ayant appartenu aux Cherokees. Don O’Hara se souvenait que le père de son père avait connu ce gaillard-là, un robuste lascar, brutal et sans manières. Un homme sans foi ni loi, ayant participé à l’accaparement violent du territoire indien, et qui n’avait qu’un seul credo : la force.
Il avait fait partie de ces colons qui estimaient que cette terre conquise serait la leur pour des siècles et des siècles. « Ils n’avaient pas tout à fait tort, avait admis Don O’Hara. Un bon siècle plus tard, les Cooper, comme bien d’autres familles, restent maîtres des terres. »
Le dressage, l’élevage des chevaux avaient toujours été l’apanage des Indiens. J.A. Cooper s’était emparé de tout ça. Mais aussi des troupeaux de bovins, conduits aux champs et gardés par des hommes de peine qu’il payait à coup de lance-pierres. Pas sûr d’ailleurs que ces cow-boys aient eu jamais le plus petit salaire, Cooper considérant que le gîte et couvert les payaient largement en retour.
Il était devenu très vite le plus grand éleveur du pays et sa maison de style colonial en témoignait. Une imposante maison, bâtie sur une petite colline dominant les espaces infinis dévolus au bétail. Une maison juchée sur les hauteurs, comme une vigie veillant sur les Terres Hautes.
En bas, coulait la Snake, une rivière sinueuse épousant maints méandres à la manière d’un long serpent. La même rivière que Cooper avait détournée sur ces terres, pour que bût son bétail et que crût le maïs qu’il comptait bien planter un jour prochain pour nourrir ses troupeaux et ses hommes de main.
Mme Rose Cooper, solide et généreuse femme, avait donné huit beaux enfants à son éleveur de mari. Des garçons en grand nombre, pour deux filles seulement. Le Révérend, arrivé de fraîche date, les avait baptisés, confiant leurs destinées à Dieu.
Mais le Seigneur n’avait pas dû comprendre le Révérend puisque trois des garçons et une fille étaient morts, tous emportés par une maligne typhoïde. Restaient heureusement trois gars costauds pour seconder James Archibald dans le dressage des chevaux et la maîtrise de la main d’œuvre aux champs.
Un jour ou l’autre, quand J.A aurait fait son temps en ce monde, l’aîné des gars, Jonas James, reprendrait le flambeau pour prolonger la lignée des Cooper destinée à survivre. James Archibald avait toujours pensé que Dieu avait toujours voulu qu’il s’implantât et creusât son sillon dans cette région des Terres Hautes.
Tout ça, raconté par Mr O’Hara, tenait bien sûr de notre grande Histoire. Mais nous, nous n’en percevions que l’écho. Nos jus de pomme torchés, Jim s’était essuyé la bouche avec son dos de main et Mr O’Hara avait repris l’histoire de la famille Cooper.
« C’est simple ! Quand vous arrivez par la route qui conduit aux Terres Hautes, vous la voyez de loin la maison des Cooper ! Certains l’appellent le Château, du fait qu’elle domine toute chose. Faut dire qu’elle en impose ! Les jours d’orage, elle apparaît comme un galion qui aurait échoué sur un récif, fouetté brutalement par le vent et la pluie.
Le Doc m’en a parlé, un jour qu’il rentrait de tournée. Dans cette immense maison vit aujourd’hui Jason, le dernier des Cooper, enfin, lui, sa deuxième épouse et sa grande famille, une ribambelle de mioches et deux grands fils, qu’il aurait eu d’un premier lit, Alan et Harold Cooper. Alan ressemble à son arrière-grand-père, taillé comme James Archibald.
Il est, à ce qu’on dit, aussi violent que lui. Son frère, Harold, est moins grossier et tient probablement de celle qui l’enfanta, Amanda Sue, une baptiste, fille de pasteur, morte en couches. Bref, aujourd’hui, Jason, le patriarche des Terres Hautes est assisté dans ses affaires par ses garçons. »
Don O’Hara, s’étant brusquement tu, avait fini son jus de pomme. Nous, on le regardait s’humecter le gosier. C’était drôle que de voir bouger sa pomme d’Adam
— Et les autres familles des Terres Hautes, avait demandé Jim.
— J’y viens, avait répondu Mr O’Hara, prenant son temps pour allumer un maousse cigare.
Après l’avoir tété comme un beau diable, il s’était vu bientôt masqué par une épaisse volute. Sa tête était réapparue, auréolée d’un dernier rond, qui rappelaient ces images pieuses distribuées pendant l’office par la dévote Mme Holy.
Don O’Hara n’avait pourtant rien d’un saint homme. Il aimait la bonne chère et les gâteaux que son épouse était seule à pouvoir lui servir. De gros gâteaux nappés de miel ou de sirop d’érable, que nous avions déjà goûtés et que Jim adorait.
Moi, je laissais souvent ma part à Jim ou à Don O’Hara pour la bonne raison qu’ils me semblaient trop sirupeux et souvent franchement écœurants.
Avec sa tête toute rougeaude, ses favoris et sa bedaine rassurante, Don O’Hara était ce qu’on appelle un bon vivant. Il buvait volontiers son alcool de maïs et ne dédaignait pas la bière, bière dont Mme O’Hara se servait pour arroser l’oie du dimanche. Peut-être bien que Ma avait raison quand elle disait qu’il avait tout d’un homme « aimant la vie ».
« Un homme sage, mais qui aime la vie, » qu’elle répétait à chaque fois qu’on prononçait son nom dans la conversation. Mais ça, c’était l’avis de Ma. Ma avait plein d’avis du même tonneau. Il suffisait qu’on parlât d’un tel ou d’un tel pour qu’elle sortît de son chapeau une phrase, censée résumer la personne en question.
« Mais revenons à nos moutons ! avait poursuivi Mr O’Hara, tout en mâchouillant son cigare. Les deux autres familles tenant les rênes des Terres Hautes, les Sanders et les Peterson, n’ont jamais eu le lustre de la famille Cooper, même si, grâce à Oswald Sanders, nous vivons du tabac aujourd’hui.
Le Vieux Sanders, comme les gens des Terres Hautes l’appellent encore quand ils évoquent sa mémoire, avait flairé l’affaire juteuse quand il s’était accaparé les lopins de tabac que cultivaient les Cherokees. Une aubaine pour lui. En l’espace de dix ans, ses champs de tabac s’étaient peu à peu étendus, mordant parfois sur les parcelles de maïs de J.A. Cooper, ce qui provoquait des frictions entre les deux familles.
La vieille rivalité Cooper-Sanders datait de cette époque. Mon grand-père m’en a maintes fois parlé, avait ajouté O’Hara en rallumant son gros cigare. Les Sanders qualifiaient les Cooper de bouseux, vu les quintaux de bouse que les troupeaux de ces derniers laissaient sur les chemins. Et les Cooper traitaient le clan Sanders d’esclavagistes pour les nombreux traîne-misère travaillant dans leurs champs.
Le vieux Sanders avait eu deux garçons. Après sa mort, ceux-ci avaient repris l’entreprise familiale, l’un s’occupant du travail des champs, de la récolte et du séchage quand l’autre négociait et vendait les ballots de tabac aux services du comté. Le second étant mort, emporté par une fièvre, sans avoir laissé derrière lui l’ombre d’une descendance, tout revint au premier qui légua au seul fils qu’il avait l’ensemble du domaine.
Là, Mr O’Hara avait fait une pause et proposé une tournée de jus de pomme. Nous lui avions tendu nos verres.
— Ah, non ! Je fais pas le service ! avait lancé Don O’Hara.
C’est Jim qui s’y était collé, me servant au passage une sacrée rasade. Mais Mr O’Hara avait hoché la tête.
« Lee John Sanders, avait-il repris d’une voix plus claire, qu’on aurait dit comme rafraîchie par sa gorgée de jus de pomme. C’est lui qui, aujourd’hui, dirige d’une main de fer les journaliers qui triment dans les champs de tabac occupant la moitié des Terres Hautes.
Cet héritier Sanders, aussi riche que Crésus, est aujourd’hui le gros planteur de la région et c’est par lui que beaucoup vivent ici. Beaucoup d’Indiens, sachant déjà ce qu’était un plant de tabac, ont été recrutés par Lee John.
Mais aussi un bon nombre de Noirs, provenant du comté voisin, les mêmes qui, pensant fuir une terre esclavagiste, ont retrouvé une autre, plus codifiée et tout aussi cynique. Certains Indiens pourtant, du fait de leurs grandes compétences, sont devenus de précieux contre-maîtres, dévoués corps et âme à Sanders.
Depuis dix ans, — il faut le dire, vu que chacun pensait depuis toujours que les deux camps étaient partis pour s’étriper jusqu’à la fin des temps, — une paix durable a été instaurée entre Jason Cooper et Lee Sanders. Un accord entre riches, chacun trouvant dans cette entente bien comprise de multiples avantages. Celui, surtout, de mener leurs affaires à leur guise, loin des directives du comté et dégagés de toutes contraintes qui pourraient nuire à leur chiffre d’affaires. »
Cette fois, c’est Fanny O’Hara qui, en sortant sur la terrasse, avait cru bon d’intervenir, pensant que nous étions captifs de son mari.
— Ne crois-tu pas que tu devrais les libérer, Donald !
— Oh, non ! avait dit Jim.
— Est-ce si sûr que ça, Lenny ?
— Sûr, Mme O’Hara.
Elle avait dû battre en retraite, en fronçant les sourcils et en pensant sans doute qu’il n’y avait pas pire trio sur cette terre.
Pas mécontent de cette mise au point et après avoir ri sous cape, Don O’Hara avait voulu conclure la grande histoire des Terres Hautes.
« Bon, les enfants, je n’aurais pas fini de vous parler des Terres Hautes si j’oublie d’évoquer la famille Peterson. James Peterson, militaire de carrière, sorti vainqueur aux côtés des Nordistes, avait eu le nez fin quand il avait quitté l’armée, en s’octroyant des terres où passerait plus tard la ligne de Chemin de Fer.
Une fois installé, il avait commencé par louer ces terres-là à Cooper pour que les bêtes d’Archibald puissent paître en toute liberté. Mais quand l’Etat lui avait proposé d’acheter une partie de celles-ci à prix d’or pour y acheminer la première voie ferrée desservant le comté, il n’avait pas dit non.
C’est ainsi qu’en vendant toutes ses terres, James Peterson était devenu riche, très riche. D’une richesse indécente, enfin, si la richesse n’est pas déjà en soi une indécence. Sa fille, — il n’avait eu qu’une fille, avait hérité de l’immense fortune de son père.
Elle avait eu un fils, grâce aux bons soins d’un cow-boy de passage, Will Aaron, le même qui, aujourd’hui, ne vit que grâce à des placements et autres actions bancaires que son comptable gère. On peut même dire que cet homme-là gagne de l’argent rien qu’en dormant ! »
Ça m’en avait bouché un coin, cette histoire-là. Je m’étais même imaginé ce Peterson, allongé dans un lit fastueux, la tête posée sur un édredon d’or, avec des billets de banque qui dépassaient de l’édredon. Car pour nous autres, pour Pa et Ma, pour tous les autres qui se brisaient les reins sur leur lopin de terre, on ne gagnait sa vie qu’en trimant tant et plus. Mr O’Hara en avait convenu quand j’en avait parlé, hochant bienveillamment la tête et son hochement semblait me dire « Tu as raison, Lenny !
La vie ne distribue pas à tous les mêmes cartes. » Puis il avait rallumé son cigare et en avait tiré une profonde bouffée.
« Enfin, voilà comment sont nées les Terres Hautes ! avait-il marmonné. La prochaine fois, je vous raconterai l’arrivée sur nos terres de ce foutu Chemin de Fer ! Mon grand-père m’en a tant parlé que je connais tout ça par cœur ! Allez, Lenny, tu dois filer ! Ta famille doit t’attendre ! ».
Jim avait demandé à Mr O’Hara de me raccompagner un bout de chemin.
— D’accord, mais ne traîne pas !
Le soir allait tomber. Au loin, le ciel était rougeaud, comme la tête de Mr O’Hara. Il n’y avait plus aucun vent, juste un piaillement clair, un peu plaintif, dans le feuillage de l’énorme sycomore qui ombrait la terrasse, durant les longs après-midis d’été. Jim m’avait donné une bourrade et il avait couru à toutes jambes, tournant la tête pour voir si j’étais à ses trousses. Pour sûr que j’étais à ses basques : il ne pensait quand même pas que j’étais une mauviette !
Patville, un feuilleton signé Yves Carchon, écrivain, auteur de "Riquet m'a tuer", de "Vieux démons", de « Le Dali noir », et de son nouveau polar « Le sanctuaire des destins oubliés »

Retrouvez
Covid-19 : Le Feuilleton | Chapitre 6 | Collins contre tous
Covid-19 : Le Feuilleton | Chapitre 5 | Le bagne d’Oraculo
Covid-19 : Le Feuilleton | Chapitre 4 | Le village de nous autres
Covid-19 : Le Feuilleton | Chapitre 3 | Les culs terreux
Covid-19 : Le Feuilleton | Chapitre 2 | Les culs terreux
Covid-19 : Le Feuilleton | Chapitre 1 La fin des temps
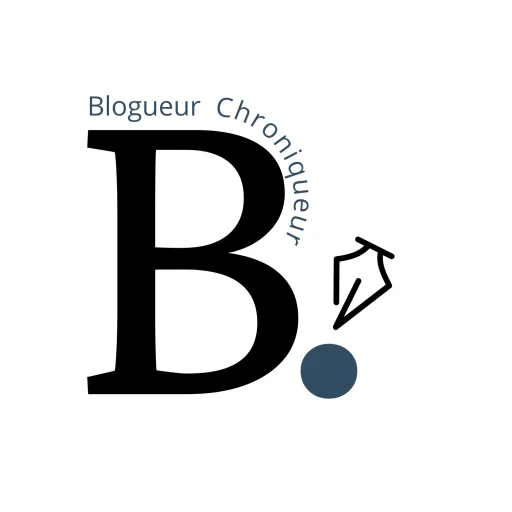
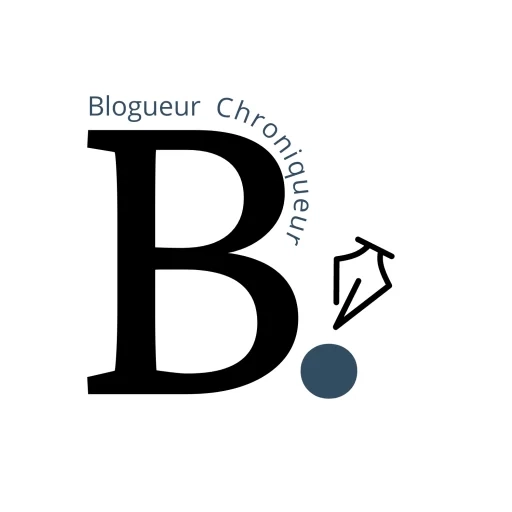









Salut
Le temps est ensoleillé entrecoupé de petites averses.
Pas de sortie prévue aujourd’hui, on regarde la télé.
Et puis j’ai réfléchit sur la police de demain…
Je vous souhaite un bon dimanche
merci